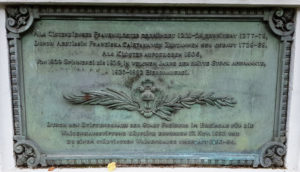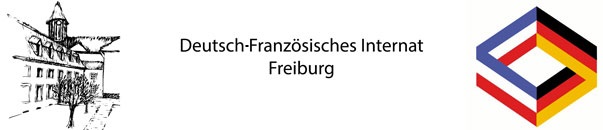brève histoire de l’Internat franco-allemand
Le concept de Lycée franco-allemand exige nombre important d’élèves français. Ces élèves viennent, depuis la création du lycée, pour une grande part de l’Alsace toute proche ou de plus loin, au cœur de la France, mais également des garnisons françaises stationnées en Bade-Wurtemberg, et, depuis quelques années d’autres pays européens, voire d’Afrique et du Canada.
Depuis la création du Lycée franco-allemand, en septembre 1972, les élèves français ne résidant pas à Fribourg étaient hébergés dans différentes pensions ou foyers pour jeunes. Ces institutions étaient : la fondation Melanchton, Mercystraße, le foyer Ste Luitgard, Quäkerstraße, la pension Ste Ursule, Landknechtsstraße et le foyer Margrave du Pays de Bade, Kartäuserstraße.
Le nombre d’élèves venus de l’extérieur passant de 10, aux tous débuts, à plus de 30, la constitution d’un internat rattaché au Lycée franco-allemand se fit plus pressante. À cela s’ajoute que l’hébergement des élèves dans diverses institutions posait de sérieuses limites au suivi pédagogique. Au demeurant, les écoles allemandes ont d’autres périodes de vacances que le lycée franco-allemand.
C’est à la suite de nombreux pourparlers entre le gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg et de la ville de Fribourg, tous deux garants financiers du Lycée franco-allemand, que l’Internat franco-allemand fut établi, en septembre 1979, dans le Foyer St. Georges, Habsburgerstraße, ancienne résidence étudiante de l’archevêché de Fribourg. L’accord entre la ville et le Land stipule que l’internat est essentiellement ouvert aux élèves de la section française dont les familles vivaient à une distance trop éloignée de Fribourg pour être parcourue tous les jours. Les élèves qui ne pouvaient pas rentrer chez eux le week-end pouvaient rester à l’internat mais devaient subvenir eux-mêmes à leurs besoins.
En 1979, le montant dont les parents devaient s’acquitter pour un enfant était de 250 marks. Il s’agissait-là d’une somme conséquente pour des familles nombreuses. C’est pourquoi bien des familles françaises ne pouvaient envoyer qu’un seul enfant à Fribourg ; une situation particulièrement pénible car l’institution n‘était pas sensée ne s’adresser qu’aux couches aisées de la société. C’est ainsi que fut créée la Fondation de l’internat, en 1988, dont le but est, grâce aux cotisations de ses membres ainsi qu’à des dons, de mettre à disposition des bourses pour des élèves nécessiteux et doués. Une aide dont peuvent bénéficier 12 à 15 élèves, en moyenne, par an.
Au début, les 35 internes présents étaient encadrés par le directeur de l’internat, dont le poste était conçu comme professeur déchargé d’une partie de ses cours au lycée, un autre professeur à temps partiel à l’école, une éducatrice à mi-temps et un éducateur à plein temps. Ils étaient secondés par cinq étudiants, auxiliaires pédagogiques. En cinq ans, de la création à 1984, le nombre des internes passa à 50, et ceci par le seul fait du bouche à oreille.
Fin 1984, l’administration épiscopale mit fin au contrat de location de la Habsburgerstraße pour besoins propres. À la fin de l’année scolaire 1984/85, l’internat déménagea pour l’ancien orphelinat de la Fondation de la ville de Fribourg, à Günterstal, Klosterplatz 2a. Le nombre des internes augmenta jusqu’à atteindre 75 au début des années 90. Il n’était plus nécessaire que l’internat reste ouvert le week-end, option qui fut retirée. Officiellement, l’internat était ouvert du dimanche 18h, au vendredi 14h.
Au milieu des années 90, le nombre des internes ne cessa de décroître. Les raisons en était, d’une part, le retrait des forces d’occupation françaises du Bade-Wurtemberg à partir de 1992, et d’autre part la mise en place d’un bus scolaire en partance de Mulhouse et Colmar pour les élèves du Lycée franco-allemand. Ceci permit à de nombreuses familles alsaciennes de se passer de l’internat. Par ailleurs, beaucoup d’élèves du 2nd cycle se plurent à prendre des chambres communes en ville, échappant ainsi au règlement de l’internat.
À partir de 2001, le nombre des internes chuta au-dessous des 45. La ville et le Land se posèrent la question de savoir si l’internat était encore utile. La direction de l’école concerta l’équipe pédagogique alors constituée du directeur de l’internat, de deux éducateurs à plein temps, d’une éducatrice à mi-temps, de trois professeurs employés chacun 15 heures